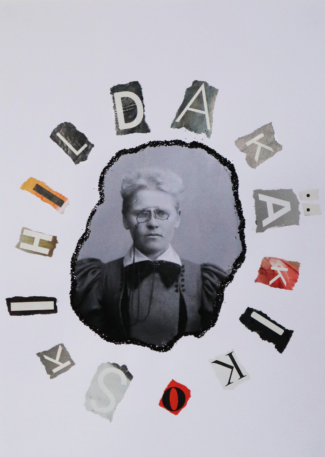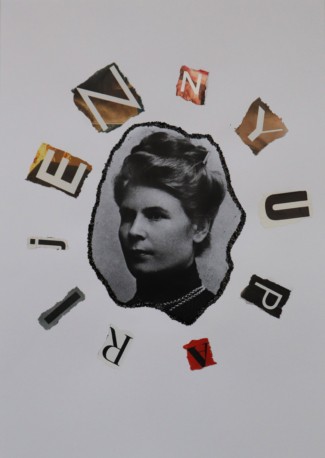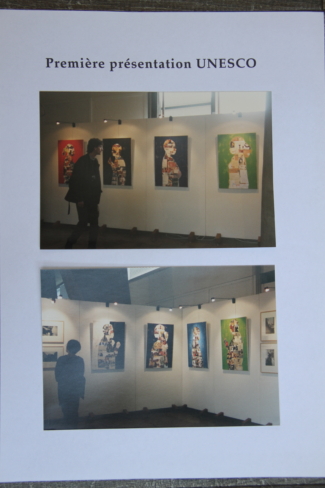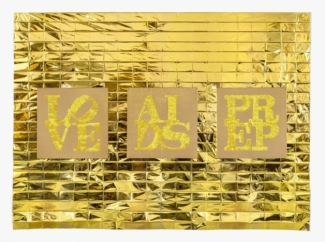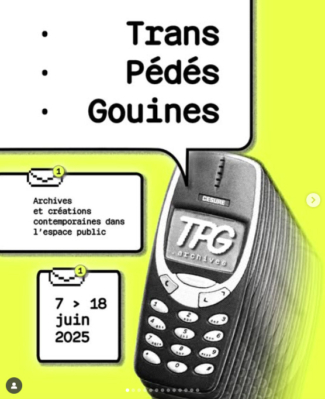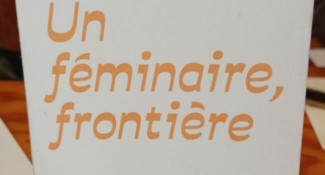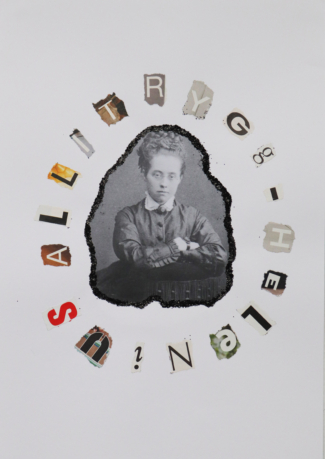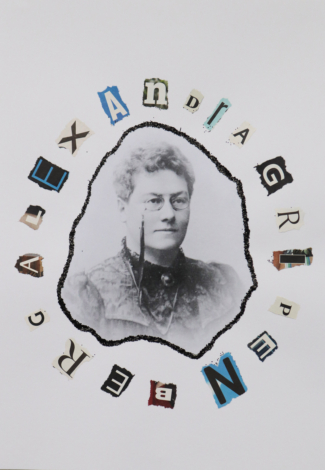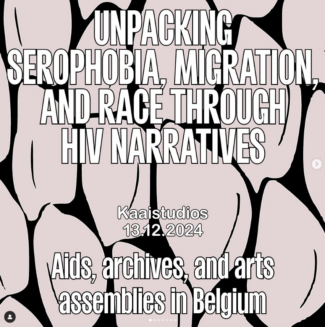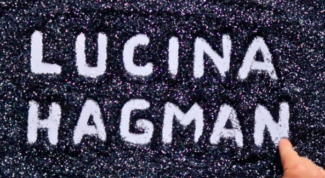
Auteur/autrice : pascal lievre

Les papiers des sans papiers
1997 — Documenta (Kassel, allemagne) 2 & 3 Juillet 1997 table ronde avec les soutiens des sans-papiers de Paris et expositions des tableaux
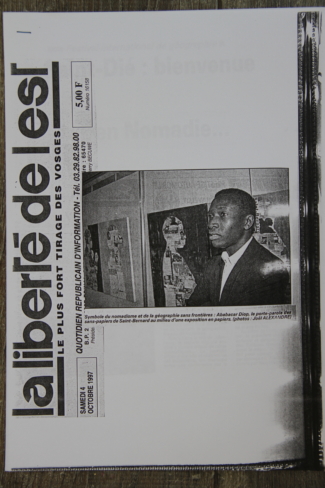
Les papiers des sans papiers
1997 — Article dans le Journal La liberté de l'est
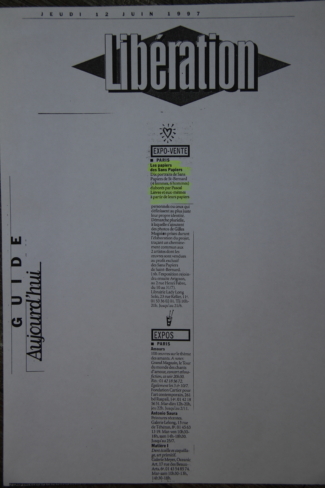
Les papiers des sans papiers
1997 — Journal Libération
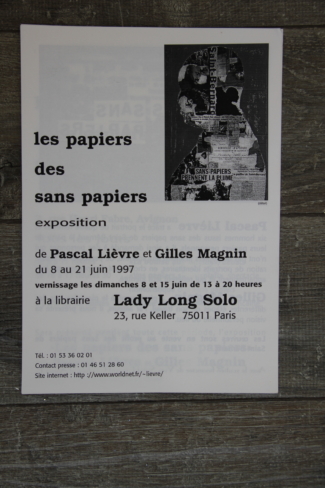
Les papiers des sans papiers
1997 — Exposition juin 1997 à la librairie Long Solo, Paris

Les papiers des sans papiers
1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers
1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers
1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers
1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm
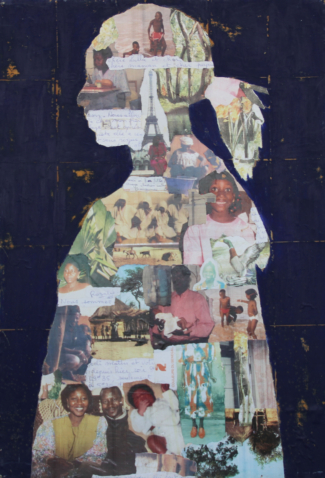
Les papiers des sans papiers
1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers
1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers
1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm
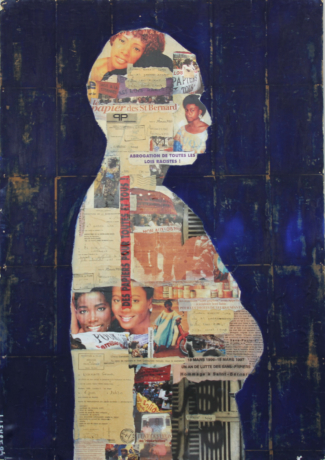
Les papiers des sans papiers
1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Statement
2001 — Entre 1999 et 2001 Pascal Lièvre entreprend de réaliser une série d’œuvres à partir d’un corpus de diapositives empruntées à la bibliothèque Forney de Paris. Il souhaite construire un alphabet de formes et faire apparaître à travers cette série de peintures, une histoire des corps représentés. Il établit dans un premier temps un collage de douze feuilles de papier Ingres, construisant ainsi une trame mesurant 114 x 121 cm qui sera la même pour toutes les œuvres. Chaque œuvre originale sera donc réduite à la même échelle, jouant ainsi avec la mise au carreau cette technique utilisée en dessin qui permet ou facilite la copie d'une œuvre. Ensuite, il projette les images des tableaux, pour en redessiner les corps, humains et non humains, il élimine tout le reste des éléments qui compose l’oeuvre même si de temps en temps subsiste un objet dans certaines peintures. Toutes les figures sont remplies de peinture acrylique noire, ce qui donne l’impression que ce sont des ombres chinoises formant un « théâtre d’ombres ». Une fois terminée, les feuilles de papier sont recouvertes d’huile de lin qui a la faculté avec le temps de rendre les feuilles de papier transparentes. Il en résulte un ensemble d’œuvres commençant en 1285 avec Cimabue et se terminant en 1995 avec Mike Kelley. Une des particularités de la série c’est que toutes les œuvres ont été peintes par des hommes. Depuis la renaissance l’art étant majoritairement aux mains des hommes, ce n’est que dans les deux derniers siècles que les femmes sont apparues pour écrire aussi une autre histoire. Pascal Lièvre imagine cette série d’ombres chinoises, comme les ombres d’une histoire de l’art passée et dépassée et fait référence au théâtre d’ombres projetées dans la caverne de Platon. Il aimerait présenter la série dans son ensemble dans un espace peu éclairé, comme si nous pénétrions dans une caverne, afin de mettre celleux qui regardent aujourd’hui dans la position de ceux qui étaient enchaînés dans l’allégorie de la caverne de Platon obligés de voir un monde fabriqué d’illusions éloigné de la réalité. Le titre de la série alphabet mnémonique fait référence à l’atlas mnémosyne de l'historien de l'art allemand Aby Warburg cet important corpus d'images, absolument original et unique, dont l’ambition n’était rien moins, que de poser les fondements d’une grammaire figurative générale. A une échelle plus modeste, cette série de Pascal Lièvre envisage une grammaire des corps dans la peinture, de la renaissance à aujourd’hui.

2004 — 2010 — Parodiant le M.L.F qui devient Mouvement de Libération des Formes, au cours d’une reprise d’une performance d’ORLAN en 2004, j’exploite un vide législatif, une vacance de la loi qui est aussi l’indice pour moi d’une possibilité d’action. En effet, Le droit français à la parodie (l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) aménage un statut d’exception. Cette licence reste toutefois conditionnée par la transformation substantielle de l’œuvre, qui évite la confusion avec original, et l’intention humoristique qui la motive. Refonte, hybridations, variations chromiques, ombrages, coupes, associations, collages, montages : je vais jongler avec tous les moyens plastiques dont je dispose. L’acte rejoint l’intention politique, il assoit la légitimité de ses œuvres sur la possibilité de sa reconnaissance juridique. C’est une remise en compte totale du droit de propriété des auteurices et du marché, en libérant ces formes plastiques, et en élaborant des fictions communistes des formes, je recrée un commun des formes plastiques. Ici, par exemple en soulignant le caractère de "Déjà vu" que les corps de Rineke Dijkstra empreinte à la statuaire classique et à la peinture de la renaissance, en s'appropriant ses formes.

2010 — Parodiant le M.L.F qui devient Mouvement de Libération des Formes, au cours d’une reprise d’une performance d’ORLAN en 2004, j’exploite un vide législatif, une vacance de la loi qui est aussi l’indice pour moi d’une possibilité d’action. En effet, Le droit français à la parodie (l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) aménage un statut d’exception. Cette licence reste toutefois conditionnée par la transformation substantielle de l’œuvre, qui évite la confusion avec original, et l’intention humoristique qui la motive. Refonte, hybridations, variations chromiques, ombrages, coupes, associations, collages, montages : je vais jongler avec tous les moyens plastiques dont je dispose. L’acte rejoint l’intention politique, il assoit la légitimité de ses œuvres sur la possibilité de sa reconnaissance juridique. C’est une remise en compte totale du droit de propriété des auteurices et du marché, en libérant ces formes plastiques, et en élaborant des fictions communistes des formes, je recrée un commun des formes plastiques. Ici, par exemple en utilisant la paillette pour déconstruire le statut "straight" du contexte historique masculiniste dans lequel on était produit ces formes.

2009 — Parodiant le M.L.F qui devient Mouvement de Libération des Formes, au cours d’une reprise d’une performance d’ORLAN en 2004, j’exploite un vide législatif, une vacance de la loi qui est aussi l’indice pour moi d’une possibilité d’action. En effet, Le droit français à la parodie (l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) aménage un statut d’exception. Cette licence reste toutefois conditionnée par la transformation substantielle de l’œuvre, qui évite la confusion avec original, et l’intention humoristique qui la motive. Refonte, hybridations, variations chromiques, ombrages, coupes, associations, collages, montages :Je vais jongler avec tous les moyens plastiques dont je dispose. L’acte rejoint l’intention politique, il assoit la légitimité de ses œuvres sur la possibilité de sa reconnaissance juridique. C’est une remise en compte totale du droit de propriété des auteurices et du marché, en libérant ces formes plastiques, et en élaborant des fictions communistes des formes, je recrée un commun des formes plastiques.

2025 Dreaming the dark in Finland Vera Hjelt
2025 — 30 X 40 cm
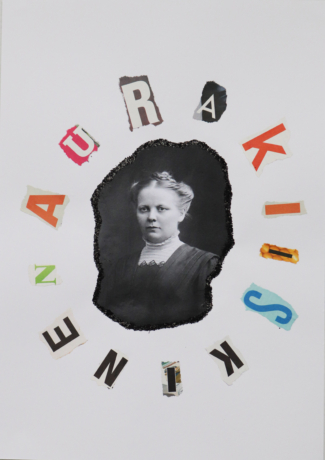
2025 Dreaming the dark in Finland Aura Kiskinen
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Tekla Hultin
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Sanna Kannasto
2025 — 30 X 40 cm
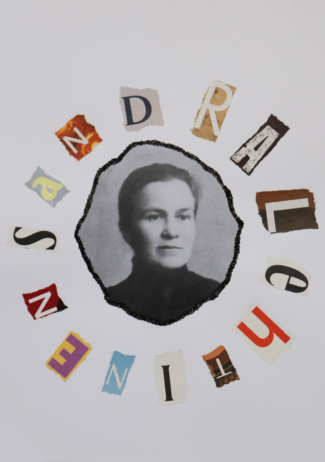
2025 Dreaming the dark in Finland Sandra Lehtinen
2025 — 30 X 40 cm
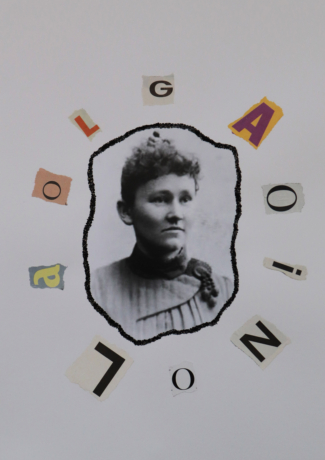
2025 Dreaming the dark in Finland Olga Oinola
2025 — 30 X 40 cm
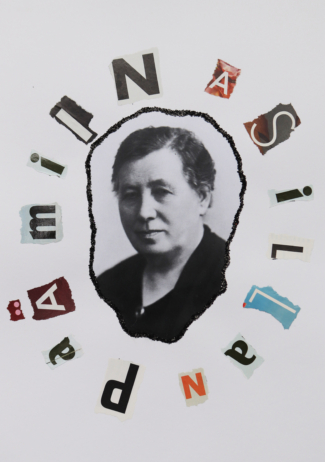
2025 Dreaming the dark in Finland Miina Sillanpaä
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Minna Canth
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Mimmi Kanervo
2025 — 30 X 40 cm
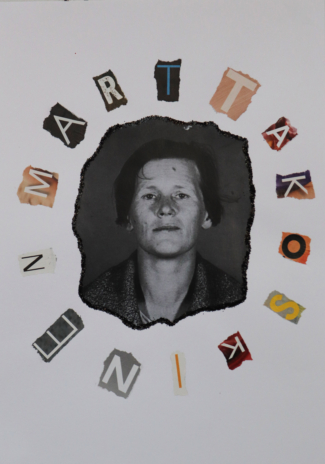
2025 Dreaming the dark in Finland Martta Koskinen
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Maria Raunio
2025 — 30 X 40 cm
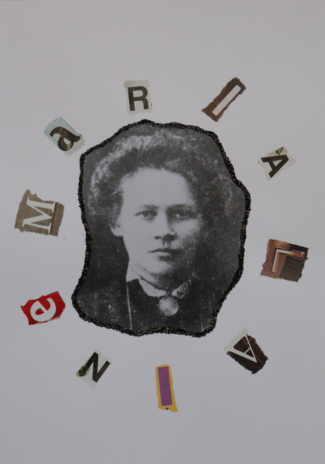
2025 Dreaming the dark in Finland Maria Laine
2025 — 30 X 40 cm
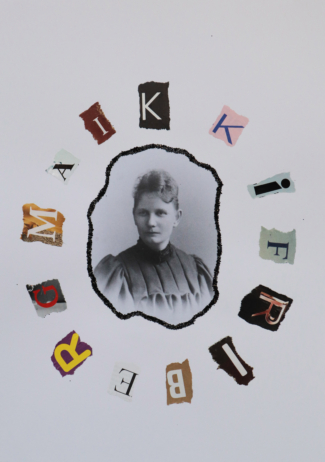
2025 Dreaming the dark in Finland Maikki Friberg
2025 — 30 X 40 cm
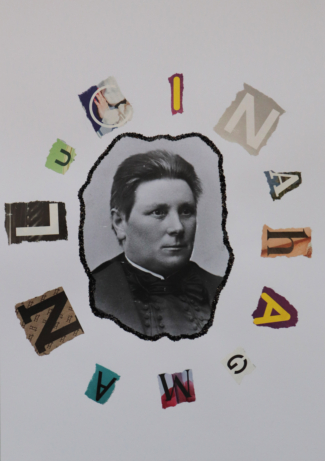
2025 Dreaming the dark in Finland Lucina Hagman
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Liisi Kivioja
2025 — 30 x 40 cm
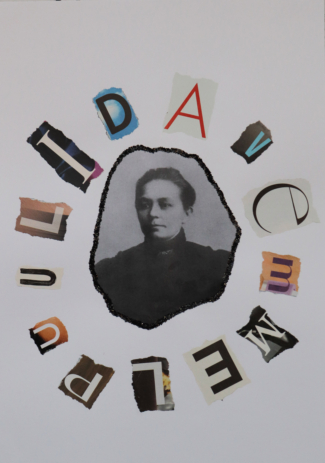
2025 Dreaming the dark in Finland Lida Vemmelpuu
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Ilma Lindgren
2025 — 30 X40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Ida-Aalle – Teljo
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Hilma Räsänen
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Hilja Pärssinen
2025 — 30 X 40 cm
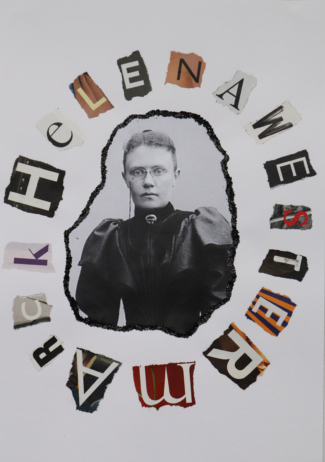
2025 Dreaming the dark in Finland Helena Westermarck
2025 — 30 x 40cm

2025 Dreaming the dark in Finland Hedwig Gebhard
2025 — 30 X 40 cm
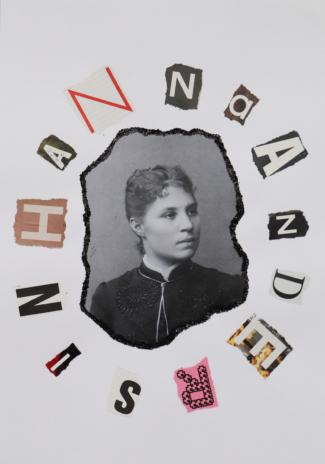
2025 Dreaming the dark in Finland Hanna Andersin
2025 — 30 X 40cm
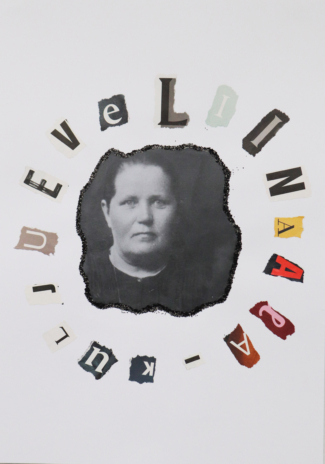
2025 Dreaming the dark in Finland Eveliin Ala-Kulju
2025 — 30 X 40cm
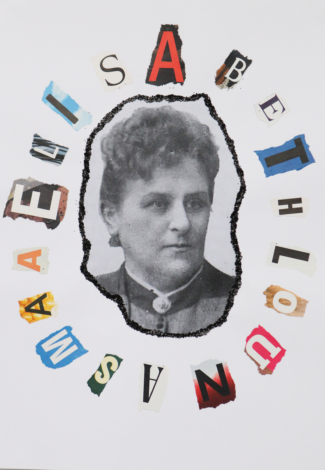
2025 Dreaming the dark in Finland Elisabeth Lounasmaa
2025 — 30 X 40cm

2025 Dreaming the dark in Finland Elin Sjöström
2025 — 30 X 40 cm
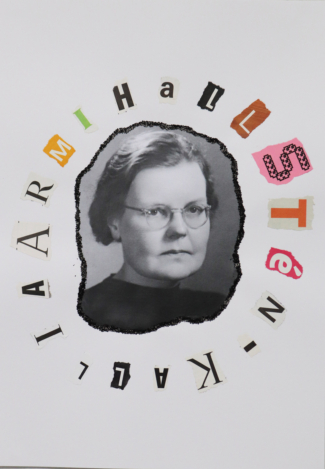
2025 Dreaming the dark in Finland Armi Hallstén-Kallia
2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Anni Huotari
2025 — 30 X 40cm
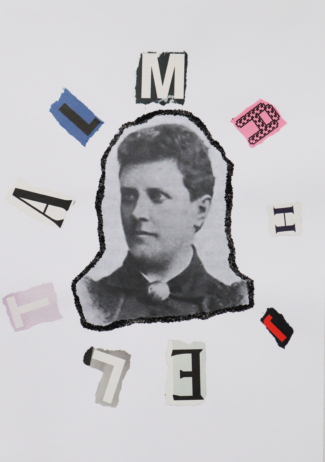
2025 Dreaming the dark in Finland Alma Hjelt
2025 — 30 X 40cm

2025 Dreaming the dark in Finland Adelaïde Ehrnrooth
2025 — 30 X 40 cm
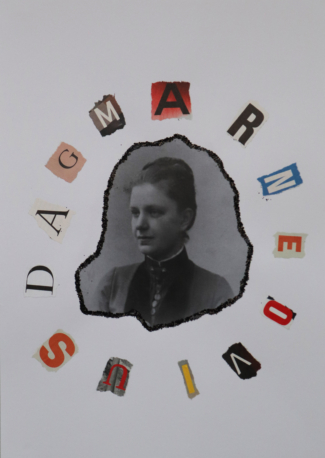
2025 Dreaming the dark in Finland Dagmar Neovius
2024 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Cely Mechelin
2025 — 30 x 40cm

Détail Collage Positiva
1995 — 120 X 70
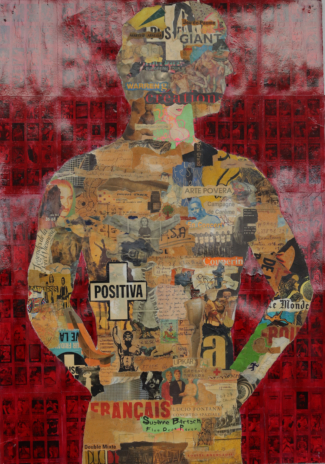
Collage Positiva
1995 — 120 X 70 cm

Collage Daniel Dezeuze
2001 — 46 x 72cm

Collage Lee Ufan Mirwais
2001 — 46 x 72cm

Collage Dante’s inferno
2001 — 46 x 72cm
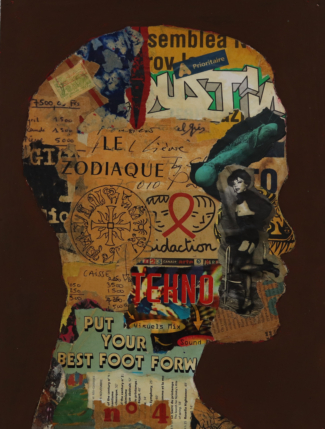
Collage Le zodiaque Sidaction
1996 — 42 X 29,5 cm
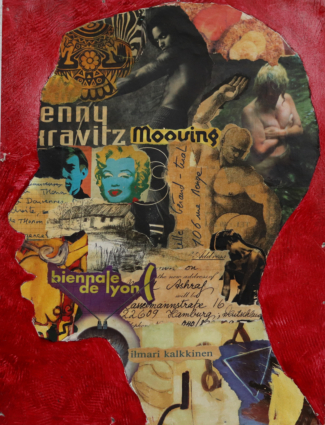
Collage Mooving
1996 — 42 X 29,5 cm

Collage Les figures de la liberté
1996 — 42 X 29,5 cm
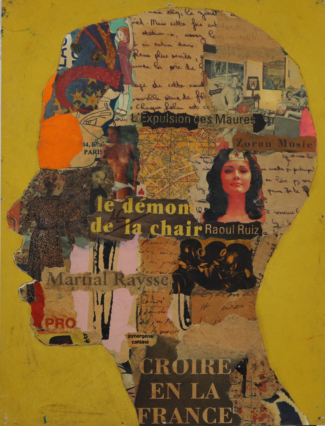
Collage le démon de la chair
1996 — 42 X 29,5 cm
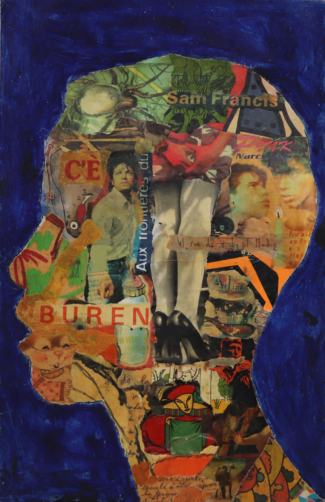
Collage Sam Francis Buren
1996 — 42 X 29,5 cm
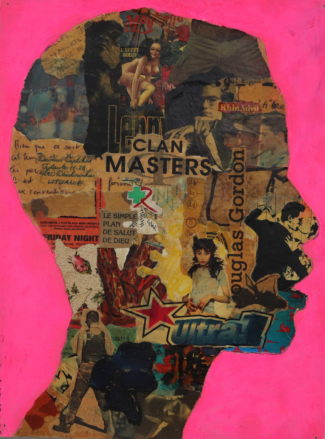
Collage Clan Masters
1996 — 42 X 29,5 cm
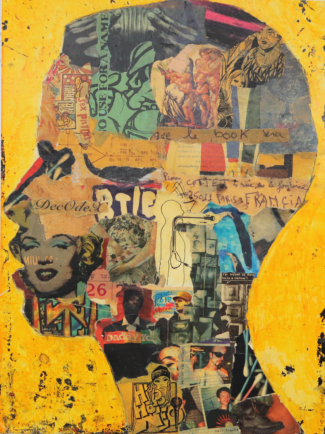
Collage Decodex
1996 — 42 X 29,5 cm
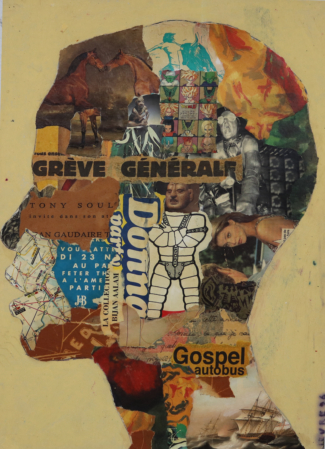
Collage Grève Générale
1996 — 42 X 29,5 cm
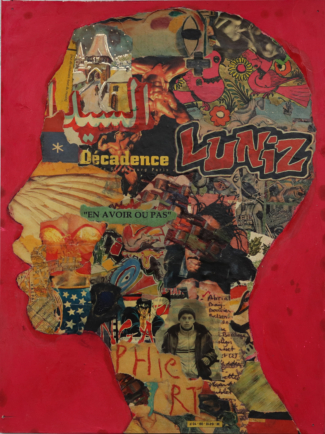
Collage Décadence en avoir ou pas
1996 — 42 X 29,5 cm
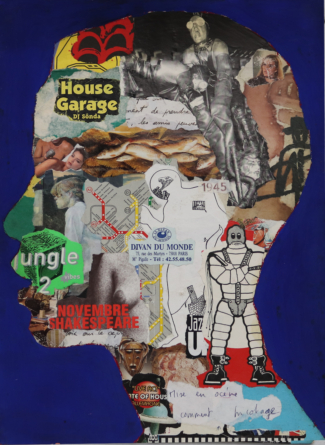
Collage House Garage
1996 — 42 X 29,5 cm
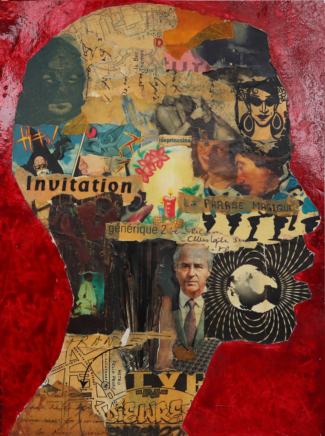
Collage La phrase magique
1996 — 42 X 29,5 cm
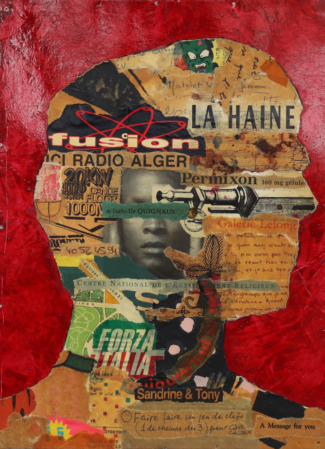
Collage La Haine
1996 — 42 X 29,5 cm

Collage Avez-vous essayé l’art contemporain ?
1996 — 42 X 29,5 cm
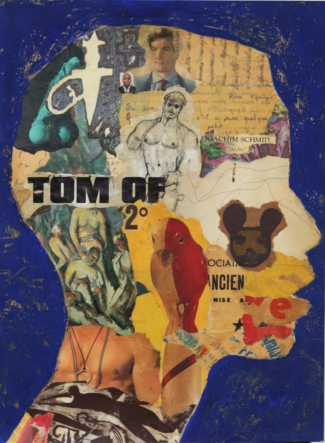
Collage Tom Of
1996
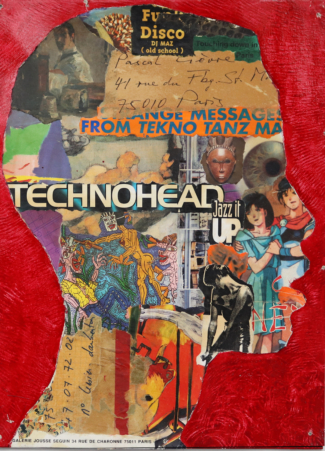
Collage Technohead
1996
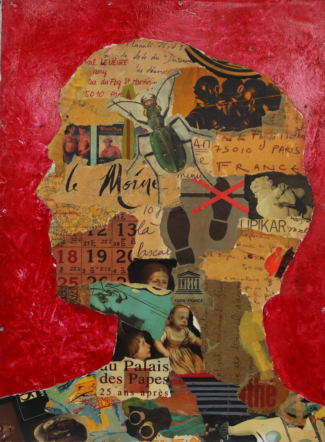
Collage Le Moine
1996 — 42 X 29,5
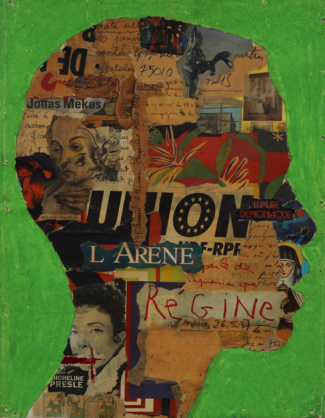
Collage Luxure démoniaque
1996 — 42 X 29,5 cm

Collage Jean-Pierre Vincent
1996 — 42 X 29,5 cm
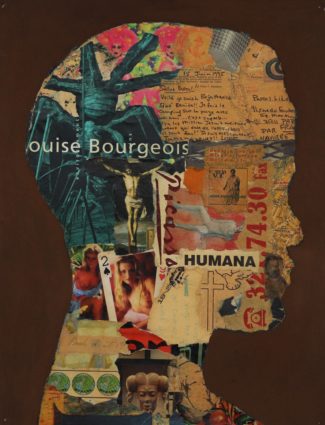
Collage Humana
1996 — 42 X 29,5 cm.

Collage Readymades belong to everyone
1996 — 42 X 29,5 cm.